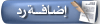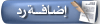Ma Ghadhnich !
Par Hakim Laâlam
Email : - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
Autoroute Est-Ouest. Aucun effondrement de tunnel ni d’affaissement
de chaussée depuis près de 6 heures et 45 minutes.
Un miracle !
Un ami — que dis-je ? — un frère tellement ce monsieur m’est proche, m’a surpris l’autre jour en m’avouant que les images de Abdekka peinant à tenir le Conseil des ministres, le très court film le montrant extrêmement affaibli, l’avaient ému, voire remué au plus profond. En langage algérien, lui qui n’a jamais pu gober la gouvernance Boutef’ depuis 1999, m’a lâché «Ghadhni !». Traduit : il m’a fait pitié ! Depuis cette discussion, je dois bien l’avouer, je gamberge ! Pas sur Abdekka, mais sur moi-même. Suis-je normal ? Suis-je dénué de toute compassion ? Et je dois bien l’avouer, mon «gambergeage» n’a pas duré longtemps. A mes yeux, aux yeux de la morale et de l’éthique qui guident ma vie, et celle de mes enfants, je l’espère, moi, Boutef’, «Ma Ghadhnich !». C’est dit brutalement, frontalement, mais ça a au moins l’avantage d’être honnête et clairement énoncé. Je ne me suis pas apitoyé en voyant ces images d’un vieillard malade. Pour une raison toute simple : comment expliquer aux veuves, aux veufs et aux enfants de Boucebsi, Djaout, Belkhenchir, Aslaoui-Hammadi, aux parents des cinq enfants du tunnel de la mort de la résidence Al-Mithak et à tous les autres que j’ai finalement failli à mon serment ? Comment leur faire admettre que j’ai eu pitié de celui qui a gratifié de titres de noblesse les assassins de leurs maris, de leurs épouses, de leurs chérubins ? J’aurais peut-être eu de la pitié pour un homme âgé et malade, mais qui aurait reconnu sa faute, admis qu’il avait blessé les mémoires meurtries des victimes du terrorisme. Mais non ! Jamais il n’a demandé pardon. Juste pardon de l’acte hautement infâme de glorifier le boucher. Et d’ailleurs, avais-je seulement le droit de pardonner à leur place ? Comment avoir pitié aujourd’hui d’un homme qui a donné la troupe contre près de deux millions de manifestants algériens venus des régions kabyles et chaouies du pays dire pacifiquement leur colère, et sur lesquels ont été déversés insultes, coups de matraques et balles ? Comment éprouver de la pitié envers un homme qui a donné son feu vert à la répression du Printemps noir, faisant couler du sang de mes compatriotes sur les trottoirs d’une portion de mon Algérie ? Des Algériens ont tiré sur d’autres Algériens, et aujourd’hui, il faudrait que j’aie pitié de celui qui a dit «Allez-y ! Tirez !» ? Comment ressentir de la pitié envers un homme qui ne s’est jamais présenté devant les familles traumatisées pour dire toute sa solidarité présidentielle, préférant la réserver aux victimes blondes et occidentales d’attentats et de catastrophes plus ou moins naturelles ? Comment éprouver de la compassion envers un homme qui nous a de tout temps parlé en roulant de gros yeux, en nous zyeutant avec haine, en nous menaçant à tout bout de champ de repartir et de nous laisser là, en traitant une partie de nous de «nains», en prenant au collet nos universitaires et nos savants, en faisant mine de chercher dans la poche de son veston le mari d’une dame qui ne demandait qu’à faire le deuil de son compagnon ? Et puis, par-dessus tout, définitivement, peut-être faut-il que je réaffirme ce que j’ai eu à écrire, ici même, à plusieurs reprises : mon aversion profonde pour cette «tradition» supposée musulmane qui consiste à pardonner mécaniquement, systématiquement, le jour de l’Aïd ou d’une quelconque autre journée du calendrier religieux à celui qui vous a offensé tout le restant de l’année. Je ne me reconnais pas dans ce dogme hypocrite. Ce n’est pas là ma religion. Je ne peux ressentir aucune pitié pour celui qui a fait souffrir les miens, mon peuple. ça peut paraître démagogique, voire un brin désuet. Ou pis, inhumain. Non ! C’est juste un profond respect que j’éprouve pour la parole donnée au bord des tombes. Je ne peux être parjure aujourd’hui. Y a-t-il plus infâme qu’un parjure aux morts ? Comment pourrais-je, demain encore, croiser Leïla sans baisser les yeux au sol, si je pardonnais à cet homme-là ? Je ne peux fuir le regard de Farida. Je ne le puis ! Je ne le veux. Et je ne le voudrais jamais ! C’est dit ! Sans haine. Mais aussi sans aucune pitié ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.
H. L.


![]() ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .